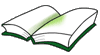| Titre : |
IMPACTS DES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES SUR LA BIODIVERSITÃ ET LES SERVICES ÃCOSYSTÃMIQUES |
| Type de document : |
texte imprimÃĐ |
| Auteurs : |
Sophie Leenhardt , Laure Mamy , StÃĐphane Pesce , Wilfried Sanchez, Auteur |
| Editeur : |
paris : Editions Quae |
| AnnÃĐe de publication : |
2023 |
| Importance : |
183p |
| Format : |
24cm |
| ISBN/ISSN/EAN : |
978-2-7592-3656-5 |
| Note gÃĐnÃĐrale : |
Impact des produits phytopharmaceutiques sur la biodiversité et les services écosytémiques |
| Langues : |
Français (fre) |
| Mots-clÃĐs : |
Contamination avÃĐrÃĐe- lâenvironnement - la biodiversitÃĐ -fonctions ÃĐcosystÃĐmiques-PhÃĐnomÃĻnes dâaccumulation - produits phytopharmaceutiques- la biodiversitÃĐ-ÃĐcosystÃĐmiques- la contamination- |
| Index. dÃĐcimale : |
577 |
| RÃĐsumÃĐ : |
Chaque annÃĐe, entre 55 000 et 70 000 tonnes de substances actives phytopharmaceutiques, incluant celles utilisables en agriculture
biologique et de biocontrÃīle, sontvendues sur le territoire français mÃĐtropolitain et dâoutre-mer et sont utilisÃĐes pour la protection des cultures
ou lâentretien des jardins, espaces vÃĐgÃĐtalisÃĐs et infrastructures (JEVI). Dans le mÊme temps, le rapport sur lâÃĐvaluation mondiale de la
biodiversitÃĐ et des services ÃĐcosystÃĐmiques ÃĐtabli en 2019 par la Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversitÃĐ
et les services ÃĐcosystÃĐmiques (IPBES) dresse le bilan alarmant dâune ÃĐrosion sans prÃĐcÃĐdent de la biodiversitÃĐ. La pollution chimique gÃĐnÃĐrÃĐe
par les activitÃĐs humaines, incluant les produits phytopharmaceutiques (PPP), est identifiÃĐe parmi les causes de cette ÃĐrosion. Cette pollution
sâajoute à dâautres pressions, comme les destructions dâhabitats causÃĐes par lâurbanisation, lâintensification des pratiques agricoles et sylvicoles,
et les consÃĐquences du changement climatique. Face à ce constat, la rÃĐglementation europÃĐenne en matiÃĻre de mise sur le marchÃĐ des PPP
vise un degrÃĐ ÃĐlevÃĐ de protection, avec en particulier pour principe dâÃĐviter tout effet inacceptable sur lâenvironnement. Toutefois, elle ne
parvient pas complÃĻtement à atteindre cet objectif, en raison notamment dâune prise en compte insuffisante de la diversitÃĐ des interactions
telles quâelles se produisent dans lâenvironnement (entre substances, entre organismes, avec une variÃĐtÃĐ de facteurs physico-chimiques, etc.).
Câest dans ce contexte que les ministres chargÃĐs de lâEnvironnement, de lâAgriculture et de la Recherche ont sollicitÃĐ INRAE et lâIfremer pour
rÃĐaliser un ÃĐtat des lieux des connaissances scientifiques relatives aux impacts des PPP sur la biodiversitÃĐ et les services ÃĐcosystÃĐmiques. La
prÃĐcÃĐdente expertise scientifique collective (ESCo) portant sur Pesticides, agriculture et environnement avait ÃĐtÃĐ rÃĐalisÃĐe en 2005. Le
prÃĐsent exercice consiste à en actualiser les rÃĐsultats, en les ÃĐlargissant à lâensemble du continuum terre-mer et en incluant les usages de PPP
relevant des zones non agricoles (JEVI). A la diffÃĐrence de celle de 2005, cette ESCo est positionnÃĐe en aval de lâutilisation des PPP, pour traiter
du devenir et des impacts de ces substances une fois introduites dans lâenvironnement. Elle ne traite pas des pratiques ou systÃĻmes agricoles
permettant de rÃĐduire les utilisations de PPP, ni des stratÃĐgies prÃĐventives de rÃĐgulation des bioagresseurs. Ces thÃĐmatiques font lâobjet
dâautres travaux en cours, notamment une autre ESCo conduite par INRAE sur la gestion des couverts vÃĐgÃĐtaux pour la rÃĐgulation naturelle des
bioagresseurs dont les rÃĐsultats sont attendus à lâautomne 2022. Ces deux exercices sâinscrivent dans le cadre du Plan Ecophyto II+, en
complÃĐment de lâexpertise Pesticides et santÃĐ humaine publiÃĐe par lâInserm en 2021.
Le pÃĐrimÃĻtre de la prÃĐsente ESCo couvre les diffÃĐrents milieux (terrestre, atmosphÃĐrique, aquatiques continental et marin, Ã lâexception des
eaux souterraines) dans leur continuitÃĐ, du lieu dâapplication jusquâà lâocÃĐan, en France mÃĐtropolitaine et dâoutre-mer, à partir de connaissances
produites ou transposables dans ce type de contexte (climat, PPP utilisÃĐs, biodiversitÃĐ prÃĐsente, etc.). Il intÃĻgre tous les produits destinÃĐs à la
protection des cultures ou à lâentretien des JEVI, quâil sâagisse de PPP conventionnels ou de produits ou agents de biocontrÃīle, dÃĻs lors quâils
sont susceptibles de se retrouver dans lâenvironnement du fait dâune utilisation actuelle ou plus ancienne. Le cadre dâanalyse mis en place
considÃĻre la biodiversitÃĐ dans ses dimensions structurelle et fonctionnelle, et il intÃĻgre la question des services ÃĐcosystÃĐmiques. Lâattention est
ainsi plus particuliÃĻrement portÃĐe sur des travaux qui documentent la mise en ÃĐvidence des risques et des effets dans des conditions
environnementales rÃĐalistes, et à des niveaux dâorganisation biologique (ex. individu, population, communautÃĐ, ÃĐcosystÃĻme) susceptibles de
faciliter le lien à ÃĐtablir avec la biodiversitÃĐ ainsi quâavec les fonctions et services ÃĐcosystÃĐmiques. |
| Note de contenu : |
Avant-propos
Introduction
Contexte
Demande dâexpertise
Principes de lâESCo
Composition du collectif dâexperts
Sources mobilisÃĐes
Cadre dâanalyse
1. PrÃĐambule sur la fragmentation des connaissances
CaractÃĻre parcellaire et hÃĐtÃĐrogÃĻne
ComplÃĐmentaritÃĐ des approches et des objets dâÃĐtude
2. Contamination de lâenvironnement par les PPP et exposition des organismes
Contamination avÃĐrÃĐe des milieux par une grande diversitÃĐ de PPP
Dynamiques de transfert et devenir des substances
Influence du contexte sur la dynamique dâexposition
Leviers pour limiter la contamination et lâexposition
Innovations et perspectives pour caractÃĐriser la contamination et lâexposition
3. Effets sur la biodiversitÃĐ
De lâexposition aux effets, sources de variabilitÃĐ de la sensibilitÃĐ aux PPP
Mise en ÃĐvidence des diffÃĐrents types dâeffets
Effets sur lâÃĐtat de la biodiversitÃĐ et ses ÃĐvolutions
ConsÃĐquences sur les fonctions ÃĐcosystÃĐmiques
Innovations et perspectives pour lâÃĐvaluation des effets
4. ConsÃĐquences sur les services ÃĐcosystÃĐmiques
Liens conceptuels entre fonctions et service
Principaux services ÃĐcosystÃĐmiques impactÃĐs
Innovations et perspectives sur les services ÃĐcosystÃĐmiques
5. Points transversaux de prÃĐoccupation ou dâamÃĐlioration
Questions relatives au choix des substances
PhÃĐnomÃĻnes dâaccumulation
AmÃĐliorations enregistrÃĐes
AmÃĐliorations apportÃĐes et difficultÃĐs persistantes sur le plan scientifique
6. Interactions entre science et rÃĐglementation
Niveau dâexigence et complexitÃĐ de la rÃĐglementation sur les PPP
Connaissances scientifiques disponibles non prises en compte
Disjonction des ÃĐvaluations avant et aprÃĻs mise sur le marchÃĐ
Pistes dâamÃĐlioration les plus documentÃĐes
Conclusion
La contamination de lâenvironnement par les PPP est avÃĐrÃĐedans tous les milieux
LâÃĐtat des lieux reste trÃĻs incomplet dans les outre-mer
Les PPP contribuent à la fragilisation de la biodiversitÃĐ
Les PPP diminuent la capacitÃĐ Ã fournir des services ÃĐcosystÃĐmiques
Les impacts dÃĐpendent fortement des modalitÃĐs et du contexte dâutilisation
Des leviers permettent dâattÃĐnuer en partie les impacts
Dans les JEVI, une reconception des modes de gestion
Lâencadrement rÃĐglementaire des PPP comporte des objectifs ambitieux qui ne sont pas complÃĻtement atteints
La mobilisation des connaissances à des fins rÃĐglementaires nÃĐcessite dâÊtre organisÃĐe
Mieux prendre en compte la complexitÃĐ des expositions et des effets
Articuler lâÃĐtude des systÃĻmes agricoles à celle des ÃĐcosystÃĻmes |
IMPACTS DES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES SUR LA BIODIVERSITà ET LES SERVICES ÃCOSYSTÃMIQUES [texte imprimÃĐ] / Sophie Leenhardt , Laure Mamy , StÃĐphane Pesce , Wilfried Sanchez, Auteur . - paris : Editions Quae, 2023 . - 183p ; 24cm. ISBN : 978-2-7592-3656-5 Impact des produits phytopharmaceutiques sur la biodiversité et les services écosytémiques Langues : Français ( fre)
| Mots-clÃĐs : |
Contamination avÃĐrÃĐe- lâenvironnement - la biodiversitÃĐ -fonctions ÃĐcosystÃĐmiques-PhÃĐnomÃĻnes dâaccumulation - produits phytopharmaceutiques- la biodiversitÃĐ-ÃĐcosystÃĐmiques- la contamination- |
| Index. dÃĐcimale : |
577 |
| RÃĐsumÃĐ : |
Chaque annÃĐe, entre 55 000 et 70 000 tonnes de substances actives phytopharmaceutiques, incluant celles utilisables en agriculture
biologique et de biocontrÃīle, sontvendues sur le territoire français mÃĐtropolitain et dâoutre-mer et sont utilisÃĐes pour la protection des cultures
ou lâentretien des jardins, espaces vÃĐgÃĐtalisÃĐs et infrastructures (JEVI). Dans le mÊme temps, le rapport sur lâÃĐvaluation mondiale de la
biodiversitÃĐ et des services ÃĐcosystÃĐmiques ÃĐtabli en 2019 par la Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversitÃĐ
et les services ÃĐcosystÃĐmiques (IPBES) dresse le bilan alarmant dâune ÃĐrosion sans prÃĐcÃĐdent de la biodiversitÃĐ. La pollution chimique gÃĐnÃĐrÃĐe
par les activitÃĐs humaines, incluant les produits phytopharmaceutiques (PPP), est identifiÃĐe parmi les causes de cette ÃĐrosion. Cette pollution
sâajoute à dâautres pressions, comme les destructions dâhabitats causÃĐes par lâurbanisation, lâintensification des pratiques agricoles et sylvicoles,
et les consÃĐquences du changement climatique. Face à ce constat, la rÃĐglementation europÃĐenne en matiÃĻre de mise sur le marchÃĐ des PPP
vise un degrÃĐ ÃĐlevÃĐ de protection, avec en particulier pour principe dâÃĐviter tout effet inacceptable sur lâenvironnement. Toutefois, elle ne
parvient pas complÃĻtement à atteindre cet objectif, en raison notamment dâune prise en compte insuffisante de la diversitÃĐ des interactions
telles quâelles se produisent dans lâenvironnement (entre substances, entre organismes, avec une variÃĐtÃĐ de facteurs physico-chimiques, etc.).
Câest dans ce contexte que les ministres chargÃĐs de lâEnvironnement, de lâAgriculture et de la Recherche ont sollicitÃĐ INRAE et lâIfremer pour
rÃĐaliser un ÃĐtat des lieux des connaissances scientifiques relatives aux impacts des PPP sur la biodiversitÃĐ et les services ÃĐcosystÃĐmiques. La
prÃĐcÃĐdente expertise scientifique collective (ESCo) portant sur Pesticides, agriculture et environnement avait ÃĐtÃĐ rÃĐalisÃĐe en 2005. Le
prÃĐsent exercice consiste à en actualiser les rÃĐsultats, en les ÃĐlargissant à lâensemble du continuum terre-mer et en incluant les usages de PPP
relevant des zones non agricoles (JEVI). A la diffÃĐrence de celle de 2005, cette ESCo est positionnÃĐe en aval de lâutilisation des PPP, pour traiter
du devenir et des impacts de ces substances une fois introduites dans lâenvironnement. Elle ne traite pas des pratiques ou systÃĻmes agricoles
permettant de rÃĐduire les utilisations de PPP, ni des stratÃĐgies prÃĐventives de rÃĐgulation des bioagresseurs. Ces thÃĐmatiques font lâobjet
dâautres travaux en cours, notamment une autre ESCo conduite par INRAE sur la gestion des couverts vÃĐgÃĐtaux pour la rÃĐgulation naturelle des
bioagresseurs dont les rÃĐsultats sont attendus à lâautomne 2022. Ces deux exercices sâinscrivent dans le cadre du Plan Ecophyto II+, en
complÃĐment de lâexpertise Pesticides et santÃĐ humaine publiÃĐe par lâInserm en 2021.
Le pÃĐrimÃĻtre de la prÃĐsente ESCo couvre les diffÃĐrents milieux (terrestre, atmosphÃĐrique, aquatiques continental et marin, Ã lâexception des
eaux souterraines) dans leur continuitÃĐ, du lieu dâapplication jusquâà lâocÃĐan, en France mÃĐtropolitaine et dâoutre-mer, à partir de connaissances
produites ou transposables dans ce type de contexte (climat, PPP utilisÃĐs, biodiversitÃĐ prÃĐsente, etc.). Il intÃĻgre tous les produits destinÃĐs à la
protection des cultures ou à lâentretien des JEVI, quâil sâagisse de PPP conventionnels ou de produits ou agents de biocontrÃīle, dÃĻs lors quâils
sont susceptibles de se retrouver dans lâenvironnement du fait dâune utilisation actuelle ou plus ancienne. Le cadre dâanalyse mis en place
considÃĻre la biodiversitÃĐ dans ses dimensions structurelle et fonctionnelle, et il intÃĻgre la question des services ÃĐcosystÃĐmiques. Lâattention est
ainsi plus particuliÃĻrement portÃĐe sur des travaux qui documentent la mise en ÃĐvidence des risques et des effets dans des conditions
environnementales rÃĐalistes, et à des niveaux dâorganisation biologique (ex. individu, population, communautÃĐ, ÃĐcosystÃĻme) susceptibles de
faciliter le lien à ÃĐtablir avec la biodiversitÃĐ ainsi quâavec les fonctions et services ÃĐcosystÃĐmiques. |
| Note de contenu : |
Avant-propos
Introduction
Contexte
Demande dâexpertise
Principes de lâESCo
Composition du collectif dâexperts
Sources mobilisÃĐes
Cadre dâanalyse
1. PrÃĐambule sur la fragmentation des connaissances
CaractÃĻre parcellaire et hÃĐtÃĐrogÃĻne
ComplÃĐmentaritÃĐ des approches et des objets dâÃĐtude
2. Contamination de lâenvironnement par les PPP et exposition des organismes
Contamination avÃĐrÃĐe des milieux par une grande diversitÃĐ de PPP
Dynamiques de transfert et devenir des substances
Influence du contexte sur la dynamique dâexposition
Leviers pour limiter la contamination et lâexposition
Innovations et perspectives pour caractÃĐriser la contamination et lâexposition
3. Effets sur la biodiversitÃĐ
De lâexposition aux effets, sources de variabilitÃĐ de la sensibilitÃĐ aux PPP
Mise en ÃĐvidence des diffÃĐrents types dâeffets
Effets sur lâÃĐtat de la biodiversitÃĐ et ses ÃĐvolutions
ConsÃĐquences sur les fonctions ÃĐcosystÃĐmiques
Innovations et perspectives pour lâÃĐvaluation des effets
4. ConsÃĐquences sur les services ÃĐcosystÃĐmiques
Liens conceptuels entre fonctions et service
Principaux services ÃĐcosystÃĐmiques impactÃĐs
Innovations et perspectives sur les services ÃĐcosystÃĐmiques
5. Points transversaux de prÃĐoccupation ou dâamÃĐlioration
Questions relatives au choix des substances
PhÃĐnomÃĻnes dâaccumulation
AmÃĐliorations enregistrÃĐes
AmÃĐliorations apportÃĐes et difficultÃĐs persistantes sur le plan scientifique
6. Interactions entre science et rÃĐglementation
Niveau dâexigence et complexitÃĐ de la rÃĐglementation sur les PPP
Connaissances scientifiques disponibles non prises en compte
Disjonction des ÃĐvaluations avant et aprÃĻs mise sur le marchÃĐ
Pistes dâamÃĐlioration les plus documentÃĐes
Conclusion
La contamination de lâenvironnement par les PPP est avÃĐrÃĐedans tous les milieux
LâÃĐtat des lieux reste trÃĻs incomplet dans les outre-mer
Les PPP contribuent à la fragilisation de la biodiversitÃĐ
Les PPP diminuent la capacitÃĐ Ã fournir des services ÃĐcosystÃĐmiques
Les impacts dÃĐpendent fortement des modalitÃĐs et du contexte dâutilisation
Des leviers permettent dâattÃĐnuer en partie les impacts
Dans les JEVI, une reconception des modes de gestion
Lâencadrement rÃĐglementaire des PPP comporte des objectifs ambitieux qui ne sont pas complÃĻtement atteints
La mobilisation des connaissances à des fins rÃĐglementaires nÃĐcessite dâÊtre organisÃĐe
Mieux prendre en compte la complexitÃĐ des expositions et des effets
Articuler lâÃĐtude des systÃĻmes agricoles à celle des ÃĐcosystÃĻmes |
|  |


 Affiner la recherche Interroger des sources externes
Affiner la recherche Interroger des sources externesIMPACTS DES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES SUR LA BIODIVERSITÃ ET LES SERVICES ÃCOSYSTÃMIQUES / Sophie Leenhardt , Laure Mamy , StÃĐphane Pesce , Wilfried Sanchez